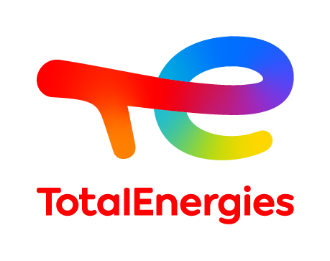Qu’est-ce qu’une batterie à décharge lente ?
L’autoconsommation consiste à consommer l’électricité produite par l’installation solaire installée sur votre habitation. Cette pratique est souvent contrainte par le décalage qui existe entre la période de production et l’utilisation. En effet, les panneaux solaires produisent l’électricité quand ils sont exposés au soleil, en journée. La majorité de la consommation a, en revanche, lieu le soir et la nuit quand la luminosité est insuffisante ou pendant vos heures de présence.
Pour pallier ce décalage, il est possible d’installer une batterie qui va stocker l’énergie en attente de son utilisation. On parle ici de batterie à décharge lente. Une batterie classique (comme celle d’une voiture) fournit une grande puissance sur un temps très court. À l’inverse, la batterie à décharge lente mise sur un fonctionnement longue durée. Elle est capable de fournir un courant régulier, sur de grandes plages de temps. Son fonctionnement est simple : la batterie se charge lorsqu’il y a du soleil et se décharge très lentement, sans aucune aide extérieure.
Quels sont les différents types de batteries à décharge lente ?
Ce dispositif est constitué de plusieurs accumulateurs, eux-mêmes formés de 3 composants : la solution — aussi appelée électrolyte — et les plaques (électrodes) négative et positive. La solution permet le passage des ions d’une plaque à l’autre, ce qui permet la charge ou la décharge.
Si vous vous renseignez sur les batteries solaires à décharge lente, vous verrez qu’il en existe quatre modèles : plomb ouvertes, plomb fermées, batteries gel ou au lithium.
Les batteries plomb ouvertes
Dans le cadre d’une batterie plomb ouverte, l’électrolyte est une solution d’acide sulfurique. La plaque positive contient du dioxyde de plomb alors que la plaque négative est constituée de plomb métallique.
Le niveau de l’électrolyte baisse au fur et à mesure des cycles de décharge, ce qui réduit la durée de vie de ce type de batterie. Ce niveau doit d’ailleurs être vérifié tous les 6 mois et éventuellement complété.
Elles sont les plus répandues, car elles offrent un bon rapport qualité/prix. Néanmoins, en raison de leur longévité plus faible, elles sont peu à peu remplacées par les modèles suivants.
Les batteries plomb fermées
Leur conception est quasiment identique à celle d’une batterie plomb ouverte, à ceci près que le niveau d’électrolyte ne diminue pas à chaque décharge.
Les batteries gel
Dans ce modèle, l’électrolyte est enrichi en gel de silice, ce qui augmente considérablement sa consistance. Une batterie gel est plus performante : décharge plus longue, nombre de cycles plus importants. En contrepartie, elle coûte plus cher que les batteries plomb classiques.
Les batteries au lithium
Ce quatrième type de batterie est le plus récent. Avec du sel de lithium comme électrolyte, elle affiche des performances exceptionnelles et un encombrement réduit. Sans surprise, le budget est également le plus élevé.
Pourquoi choisir une batterie à décharge lente ?
Opter pour une batterie à décharge lente permet d’augmenter votre autonomie énergétique. À la clé, un meilleur confort d’utilisation, particulièrement dans les régions où l’ensoleillement est variable. En parallèle, vous réduisez votre facture d’énergie en vous émancipant des variations tarifaires des cours de l’énergie.
De plus, les batteries à décharge lente présentent de nombreux avantages :
- Une décharge longue : elles offrent 3 à 5 jours d’autonomie.
- Un nombre important de cycles de charge/décharge. Ce paramètre est essentiel pour assurer la longévité du matériel et la performance globale de votre installation. Il varie de 400 cycles à plus de 7 000 cycles en fonction de la technologie.
Les batteries gel et au lithium offrent en plus les points forts suivants :
- aucun entretien ;
- pas d’écoulement en cas de casse ;
- la possibilité de les utiliser dans toutes les positions ;
- une capacité de stockage plus grande.
Comment choisir une batterie à décharge lente ?
Pour déterminer la batterie idéale pour votre système photovoltaïque, commencez par tenir compte de la puissance de votre installation. En effet, il existe des batteries 6V, 12 V, 18V, 24V et 48V avec des capacités allant de 50 à 200 Ah. La quantité d’énergie stockable est calculée en multipliant la capacité par le voltage. Par exemple, une batterie de 24 V avec une capacité de 50 Ah peut stocker 1 200 Wh.
Ensuite, réfléchissez à votre autonomie. Si vos besoins sont de 1 000 Wh par jour, préférez un modèle de 3 000 Wh pour 3 jours d’autonomie. Une batterie de 24 V et 125 Ah pourra convenir. Notez aussi que les batteries portent les symboles C5, C20 ou C100, qui vous indiquent le temps de déchargement (5 heures, 20 heures ou 100 heures).
Les derniers points à ne pas négliger sont :
- la longévité de la batterie, soit le nombre de charges/décharge ;
- la profondeur de décharge (DoD), qui spécifie le pourcentage minimum de charge acceptable par la batterie.
Voilà un récapitulatif des cycles et des DoD pour chaque modèle.
| Type |
Cycles |
DoD (charge min.) |
| Batterie plomb ouverte |
400 à 500 |
30 % |
| Batterie plomb fermée |
500 à 600 |
30 % |
| Batterie gel |
800 à 1200 |
0 % |
| Batterie lithium |
2 000 à 7 000 |
0 à 10 % |
Bon à savoir
Comme une longévité exprimée en années est toujours plus parlante qu’en nombre de cycles, les spécialistes estiment qu’une batterie au plomb dure environ 4 ans. Ce chiffre passe à 12 ans pour une batterie gel et jusqu’à 15 ans pour une batterie lithium.

Quel prix pour une batterie à décharge lente ?
Les prix varient selon la puissance et la capacité de chaque batterie. L’élément qui a le plus de répercussions sur le coût reste sans conteste la technologie déployée. Ainsi, les prix moyens sont de :
- 150 à 400 € pour une batterie à plomb (ouverte ou fermée) ;
- 500 à 2 000 € pour une batterie gel ;
- 1 500 à 5 000 € pour une batterie lithium.
Comment installer une batterie à décharge lente ?
Il est recommandé de disposer les batteries dans un lieu clos. En les tenant à l’abri de la poussière et de l’humidité, vous optimisez leur durée de vie. Il faut néanmoins noter que tous les modèles n’ont pas besoin de la même configuration. Ainsi, les batteries à plomb doivent être stockées à plat pour prévenir les écoulements, et le local doit être bien ventilé pour éviter les risques d’explosion.
La température est également importante : quand celle-ci est trop basse, les batteries ne fonctionnent pas correctement. Il convient de respecter les informations fournies par le fabricant.
Pour une installation dans les règles de l’art et en toute sécurité, faites appel à un professionnel RGE QualiPV. Il dispose des compétences nécessaires et saura notamment régler le régulateur pour ne pas dépasser la profondeur de charge recommandée pour votre équipement.